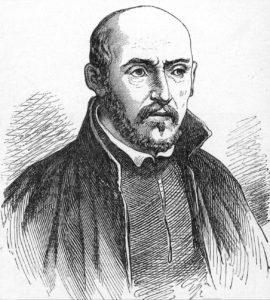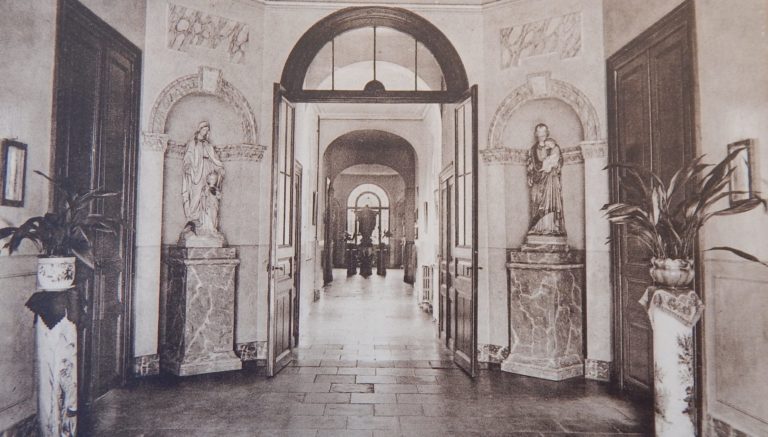Quand Iñigo naît à Loyola en 1491, l’Europe est à la veille du double bouleversement qui va la faire passer définitivement du Moyen-Âge à la Renaissance. Vers l’extérieur, c’est la découverte, par l’ouest et par l’est, de nouveaux mondes : l’Amérique (1492), le Yucatan (1517), le Mexique (1519), les côtes des U.S.A. (1528), le Canada (1534) ; mais aussi Malacca (1509) et la Chine (1514). À l’intérieur, c’est la déchirure de la Réforme protestante : Calvin naît en 1509, Luther rompt avec Rome en 1520, la Confession d’Augsbourg date de 1530, le schisme d’Henri VIII s’opère en 1531 ; puis c’est le concile de Trente (1547-1563) et la paix d’Augsbourg (1555).
Pendant ce temps, l’hégémonie turque s’affirme en Méditerranée et menace l’Europe centrale. Les Pontifes romains se succèdent, dans le faste d’une cour qui se sait la clé de voûte de l’équilibre politique en Europe : Alexandre VI (1522), Clément VII (1523), Paul III (1534), Jules III (1550), Marcel II et Paul IV (1555). Un seul monarque pourtant domine toute la scène : Charles-Quint, roi d’Espagne (1516), empereur d’Allemagne (1519) et du Nouveau Monde, qui abdiquera en 1555, l’année précédant la mort d’Ignace.